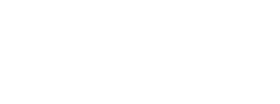Soutenance de thèse de Chiara Lai

18 décembre 202314h - 17h
Cnam de Paris / Bâtiment INETOP
41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Salle 79
Chiara LAI soutient sa thèse en Psychologie et Ergonomie, Spécialité : Psychologie.
•
Le rapport espace/activité au cœur du processus d'appropriation des nouveaux espaces de travail : Du flex-office aux environnements de travail basés sur l'activité (activity-based workspaces)
Sous la direction de M. Marc-Éric BOBILLIER CHAUMON, Professeur des Universités en Psychologie du travail (CNAM), et Mme. Maria IANEVA, Maître de conférence en Psychologie du travail au (CNAM).
Thèse effectué dans le cadre d'une Convention industrielles de formation par la recherche (Cifre) avec Colliers et le Centre de recherche sur le travail et le développement du Cnam.
Jury
- Mme Christine LAGABRIELLE, Professeure, Université de Toulouse : Rapporteure
- Mme Cécile VAN DE LEEMPUT, Professeure, Université Libre de Bruxelles : Rapporteure
- M. Gérard VALLÉRY, Professeur émérite, Université de Picardie : Examinateur
- M. Gérard VALLÉRY, Professeur émérite, Université de Picardie : Examinateur
- Mme Frédérique MIRIEL, Colliers : Invitée
- Mme Audrey ABITAN, Colliers : Invitée
Résumé de thèse
Cette thèse Cifre s’ancre dans le cadre d’une recherche-intervention menée au sein d’une entreprise de conseil en immobilier. Elle s’intéresse aux nouveaux espaces de travail dits « flexibles » (flex-office, environnement de travail dynamique etc.), que nous désignons par le terme activity-based workspaces (ABW) ou espaces de travail « basé sur l’activité ». Ces configurations couvrent une même organisation spatiale générique : des postes de travail mutualisés et non attribués, disposés au sein de plateaux ouverts et qui mettent à la disposition des travailleurs et des travailleuses un lot de ressources spatiales mobilisables par les individus et les collectifs pour soutenir leur activité. Ces espaces se basent donc sur la promesse d’une adéquation entre espace et activité, tout en véhiculant une vision prescriptrice du travail et de la manière dont il doit être fait.
Dans une perspective historico-culturelle de l’activité, nous mobilisons les approches des théories de l’activité (Clot, 1999 ; Engeström, 2001) et de la cognition située (Lave, 1988) pour appréhender l’appropriation comme un mouvement de (re)construction de l’activité du sujet, ancré dans la situation au sein de laquelle il agit, qui est historiquement constituée par son action. Dans ce cadre, comment le processus d’appropriation de ces nouveaux espaces de travail par leurs utilisateurs se trouve-t-il reconfiguré ? En quoi la mise en tension du rapport entre espace et activité, inhérente aux principes de fonctionnement de ces nouvelles formes de bureaux (Ianeva, et al., 2021) met-elle en forme voire à l’épreuve ce processus d’appropriation ? Comment dès lors concevoir des espaces qui soient des ressources pertinentes pour les sujets et leur activité ?
Dans une démarche compréhensive et qualitative, cette thèse s’intéresse dans un premier temps au processus de conception des ABW, et explore la manière dont les concepteurs appréhendent et intègrent le rapport espace/activité dans la construction de la proposition spatiale et de ses principes de fonctionnement (première étude empirique). Ensuite, elle s’intéresse aux utilisateurs des ABW, et à la manière dont (i) ils mobilisent ces solutions spatiales dans le cours de leur activité et dont (ii) ces solutions spatiales redéfinissent les contours de leurs actions par le prisme du modèle de l’acceptation située (Bobillier Chaumon, 2016) (deuxième étude empirique). Enfin, nous présentons le processus de construction d’un outil de conception basé sur la méthode de la simulation (Van Belleghem, 2021). Son objectif est d’interroger les transformations des pratiques et des représentations des concepteurs et utilisateurs en lien avec les ABW, qui permette d’ancrer le discours qui accompagne ces ABW dans le rapport espace/activité (troisième étude empirique).
Nos résultats rendent compte de (i) la manière dont les acteurs de la conception de ces nouveaux espaces de travail intègrent le rapport entre espace et activité comme un objet de travail pour penser les futurs espaces ; et (ii) la manière dont ce rapport entre espace et activité est saisi et remodelé par les utilisateurs finaux en situation de travail. L’appropriation de ces espaces se développe donc dans un mouvement dialectique où les actions de transformation de l’espace redéfinissent les contours de la cognition et de l’action.
Penser l’appropriation comme un processus de (ré)articulation du rapport entre espace et activité ancré au cœur des situations de travail des sujets peut donc se révéler être un objet opérant pour outiller les psychologues du travail-intervenants dans l’accompagnement des transformations des cadres physiques et temporels du travail des professionnels.
Mots clés : flex office, activity-based workspaces, appropriation, conception, simulation, recherche-intervention
•
Abstract
This Cifre thesis is part of a research-intervention conducted within a real estate consulting firm. It focuses on new "flexible" workspaces (flex-office, dynamic work environment, etc.), which we refer to as activity-based workspaces (ABW). These configurations cover a single generic spatial organization: shared, unallocated workstations, arranged within open platforms and providing workers with a range of spatial resources that can be mobilized by individuals and collectives to support their activity. These workspaces are thus based on the promise of a fitting relationship between space and activity, while at the same time conveying a prescriptive vision of work and how it should be done.
Based on a cultural-historical perspective on activity, we mobilize the approaches of activity theory (Clot, 1999; Engeström, 2001) and situated cognition (Lave, 1988) to approach appropriation as a movement of (re)construction of the subject's activity, anchored in the situation in which he or she acts, which is historically constituted by his or her action. From this perspective, how is the process of appropriation of these new workspaces by their users impacted? How does the tension between space and activity, inherent in the operating principles of these new forms of office (Ianeva, et al., 2021), shape or even challenge this process of appropriation? How, then, can we design spaces that can constitute relevant resources for subjects and their activity?
Using a comprehensive, qualitative approach, this thesis first looks at the ABW design process, and explores how designers apprehend and integrate the space/activity relationship in the construction of the spatial proposition and its operating mechanisms (first empirical study). It then focuses on ABW users, and how (i) they mobilize these spatial solutions in the course of their activity, and how (ii) these spatial solutions redefine the contours of their actions through the prism of the situated acceptance model (Bobillier Chaumon, 2016) (second empirical study). Finally, we present the construction process of a design tool based on the simulation method (Van Belleghem, 2021). Its aim is to investigate transformations in the practices and representations of designers and users in relation to ABWs, enabling the discourse that accompanies these ABWs to be anchored in the space/activity relationship (third empirical study).
Our results highlight (i) the way in which the designers of these new workspaces integrate the relationship between space and activity as an object of work when thinking about future spaces; and (ii) the way in which this relationship between space and activity is grasped and reshaped by end-users in work situations. The appropriation process of these workspaces is thus to understand within a dialectical movement, in which actions to transform space redefine the contours of cognition and action.
Understanding appropriation as a process of (re)articulating the relationship between space and activity, which is anchored at the heart of subjects' work situations, may therefore prove to be an effective and operative tool for work and interveners psychologists involved in supporting transformations of the physical and temporal work settings.
Keywords : flex office, activity-based workspaces, appropriation, conception, simulation, recherche-intervention, intervention research

18 décembre 202314h - 17h
Cnam de Paris / Bâtiment INETOP
41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Salle 79
 |
voir le site du CRTD |