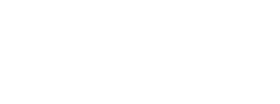Juliette Stephan

4 décembre 202514h
Cnam - site Gay Lussac
Salle 79
41 rue Gay-Lussac 75005 Paris
Juliette STEPHAN soutient sa thèse en Sciences humaines et humanités nouvelles, spécialité Psychologie
École Doctorale Abbé Grégoire
CRTD-Cnam
•
Le travail médiatisé distant à l’épreuve de la (re)connaissance de l’activité
Sous la direction de M. BOBILLIER-CHAUMON Marc-Eric, Professeur du Cnam, titulaire de la chaire de Psychologie du travail
et Mme GAUDART Corinne, Directrice de recherche au CNRS et Ergonome
Jury
-
Mme Sabrina ROUAT, Professeure de psychologie du travail, Université Lumière Lyon 2 : Présidente
-
M. Johann PETIT, Maître de conférences habilité à diriger des recherches (hdr) en ergonomie, l'Institut polytechnique de Bordeaux : Rapporteur
-
M. Gérard VALLÉRY, Professeur des Universités, Centre de Recherche en Psychologie : Cognition, Psychisme et Organisations : Rapporteur
-
Mme Maria IANEVA, Maître de conférences en Psychologie du travail, Conservatoire national des arts et métiers : Examinatrice
Résumé de thèse
Ce travail de thèse, initié en 2020, s’inscrit dans le cadre du projet « Industrie 4.0 » porté par la direction de la recherche du Cnam. Cet appel à projets vise à soutenir des travaux portant sur les transformations en cours et à venir des milieux professionnels, en favorisant le dialogue entre disciplines. Notre recherche s’ancre dans les cliniques du travail (Lhuillier, 2006) et en ergonomie de l’activité et a pour objet le développement des nouvelles formes de travail dans les milieux professionnels et leurs incidences psychosociales. Dans ce travail nous avons choisi de procéder par étude de cas dans différents milieux professionnels, volontaires pour travailler ces objets.
La crise sanitaire de 2020 a conduit de nombreuses entreprises à prendre des mesures dans l'urgence pour rendre plus flexible l'organisation du travail (Boboc, 2020 ; Ianeva et al., 2021) et maintenir leurs activités productives. Nos différents interlocuteurs (dans les secteurs de l’enseignement, commerce et télécommunication) font le constat d’un travail de réorganisation conséquent à tous les niveaux de l’entreprise pour faire face à la crise inédite. Porté par les acteurs de terrain, ce mouvement de réorganisation de l’existant a donné lieu à des configurations sociotechniques nouvelles, qui ont considérablement fait évoluer le travail et son organisation (généralisation du télétravail, passage en flex-office ou équipes distribuées, par exemple). Depuis 2020, des nouvelles modalités de travail dites « hybrides » se sont massivement installées dans les milieux professionnels. Ces transformations ont favorisé l’émergence d’une activité 4.0 (Bobillier Chaumon, 2021), c’est-à-dire une activité dématérialisée, distante, intangible, fragmentée, distribuée, individualisée et de plus en plus invisible qui vient reconfigurer le travail tant dans ce qui est à faire que dans les manières de le faire. Ce travail supplémentaire (ou méta-travail) de reconfiguration de l’existant vient s’ajouter aux tâches quotidiennes et les savoir-faire qui se développent en conséquence ne sont ni connus ni reconnus au sein de l'organisation, y compris par les professionnels eux-mêmes.
Pour éclairer ces enjeux, nous portons donc notre regard sur un objet en particulier, celui de la reconnaissance, qui demeure une notion controversée au sein des cliniques du travail. Nous proposons de (re)mettre en discussion cette notion à l’aune des nouvelles formes de travail en l’articulant avec celle d’activité pour regarder en quoi et comment ces deux objets nous permettent à la fois de mieux comprendre les transformations à l’œuvre et d’agir sur les situations professionnelles pour les développer.
Cette articulation se décline en quatre dimensions : la mise en visibilité de l’activité, en interrogeant ce qui est montré, à qui et pour quels usages, la reconnaissance de et par l’activité, à travers les processus d’appropriation du travail et de contribution au genre professionnel (Clot, 2008), et enfin l’activité de reconnaissance, qui suppose l’existence de dispositifs dialogiques rendant ces savoir-faire émergents discutables, et intégrables dans les pratiques professionnelles.
Notre méthodologie mobilise deux approches propres à l'ergonomie et à la psychologie du travail, à savoir une approche compréhensive et une approche transformatrice des activités de travail. Dans chacun de nos terrains de recherche, nous nous appliquons d’une part à caractériser ces nouvelles formes de travail qui demeurent insuffisamment qualifiées du point de vue de l’activité et d’autre part à proposer un cadre pour soutenir l’élaboration des professionnels afin de mettre en mots et reconstruire du commun à propos des nouveaux modes de travail.
•
Abstract
This doctoral research, initiated in 2020, is part of the “Industrie 4.0” research framework led by Cnam. This call for projects aims to support studies on current and future developments in professional environments by promoting dialogue between disciplines. Our research is rooted in occupational clinics (Lhuillier, 2006) and activity ergonomics and focuses on the development of new forms of work in professional environments and their psychosocial impacts. In this work, we have chosen to proceed by conducting case studies in various professional environments that are interested in working on these issues.
The health crisis of 2020 led many companies to take urgent measures to make work organization more flexible (Boboc, 2020; Ianeva et al., 2021) and maintain their productive activities. Our various interlocutors (in the education, commerce, and telecommunications sectors) report a significant reorganization of work at all levels of the company in order to cope with the unprecedented health crisis. Driven by those on the ground, this movement to reorganize existing structures has given rise to new socio-technical configurations that have significantly changed work and its organization (e.g., widespread teleworking, transition to flex-office or distributed teams). Since 2020, new “hybrid” working arrangements have become widespread in professional circles. These transformations have fostered the emergence of Activity 4.0 (Bobillier Chaumon, 2021), i.e., dematerialized, remote, intangible, fragmented, distributed, individualized, and increasingly invisible activity that is reconfiguring work in terms of both what needs to be done and how it is done. This additional work (or meta-work) of reconfiguring the existing situation is added to daily tasks, and the skills that are developed as a result are neither known nor recognized within the organization, including by the professionals themselves.
To shed light on these issues, we therefore focus on one particular object, that of recognition, which remains a controversial notion within occupational health clinics. We propose to (re)open the discussion on this concept in light of new forms of work, linking it to that of activity in order to examine how these two concepts enable us to better understand the transformations at work and to act on professional situations in order to develop them.
This articulation has four dimensions: making activity visible, by questioning what is shown, to whom, and for what purposes; recognition of and through activity, through the processes of appropriation of work and contribution to the professional genre (Clot, 2008), and finally, the activity of recognition, which presupposes the existence of dialogical mechanisms that make these emerging skills debatable and integrable into professional practices.
Our methodology draws on two approaches specific to ergonomics and occupational psychology, namely a comprehensive approach and a transformative approach to work activities. In each of our fields of research, we strive, on the one hand, to characterize these new forms of work that remain insufficiently qualified from the point of view of activity and, on the other hand, to propose a framework to support the development of professionals in order to put into words and reconstruct common ground regarding new modes of work.